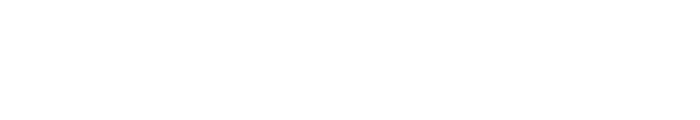Ce pourrait être à Lisbonne, Cracovie, Stockholm, Bilbao, Weimar, Florence, Paris, à Vienne et, pourquoi pas, à New York ou à Gênes même. Devant un vitrail, un ensemble de sculptures, un tableau.
Disons que vous êtes à Venise, à la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni. Un jeune homme à l’air concentré, arcbouté sur son cheval cabré, dresse sa lance dans la gueule ensanglantée d’un animal étrange sorti d’une espèce de marais, cabré face à lui. Des corps démembrés, des ossements et des crânes jonchent le sol. Au loin, sur la gauche, une ville qu’ombrent quelques palmiers marquant la perspective. A droite, derrière le cheval, une jeune fille aux mains jointes observe la scène. Nulle autre présence. Vous restez de longs instants devant cette merveille de Vittore Carpaccio.
Mais l’histoire vous fait défaut : pourquoi ces corps, cette jeune fille, cette ville, ces palmiers, cet animal étrange ?

Georges, tribun, né en Cappadoce, vint une fois à Silcha, ville de la province de Lybie. A côté de cette cité était un étang grand comme une mer, dans lequel se cachait un dragon pernicieux, qui souvent avait fait reculer le peuple venu avec des armes pour le tuer ; il lui suffisait d’approcher des murailles de la ville pour détruire tout le monde de son souffle. Les habitants se virent forcés de lui donner tous les jours deux brebis, afin d’apaiser sa fureur ; autrement, c’était comme s’il s’emparait des murs de la ville ; il infectait l’air, en sorte que beaucoup en mouraient.
Or, les brebis étant venues à manquer et ne pouvant. être fournies en quantité suffisante, on décida dans un conseil qu’on donnerait une brebis et qu’on y ajouterait un homme. Tous les garçons et les filles étaient désignés par le sort, et il n’y avait d’exception pour personne.
Or, comme il n’en restait presque plus, le sort vint à tomber sur la fille unique du roi, qui fut par conséquent destinée au monstre. Le roi, tout contristé, dit : « Prenez l’or, l’argent, la moitié de mon royaume, mais laissez-moi ma fille, et qu’elle ne meure pas de semblable mort. » Le peuple lui répondit avec fureur : « O Roi, c’est toi, qui as porté cet édit, et maintenant que tous nos enfants sont morts, tu veux sauver ta fille ? Si tu ne fais pour ta fille ce que tu as ordonné pour les autres, nous te brûlerons avec ta maison. » En entendant ces mots, le roi se mit à pleurer sa fille en disant : « Malheureux que je suis ! ô ma tendre fille, que faire de toi ? Que dire ? Je ne verrai donc jamais tes noces ? » Et se tournant vers le peuple : « Je vous en prie, dit-il, accordez-moi huit jours de délai pour pleurer ma fille. » Le peuple y ayant consenti, revint en fureur au bout de huit jours, et il dit au roi : « Pourquoi perds-tu le peuple pour ta fille ? Voici que nous mourons tous du souffle du dragon. »
Alors le roi, voyant qu’il ne pourrait délivrer sa fille, la fit revêtir d’habits royaux et l’embrassa avec larmes en disant : « Ah que je suis malheureux ! Ma très douce fille, de ton sein j’espérais élever des enfants de race royale, et maintenant tu vas être dévorée par le dragon. Ah ! Malheureux que je suis ! Ma très douce fille, j’espérais inviter des princes à tes noces, orner ton palais de pierres précieuses, entendre les instruments et les tambours, et tu vas être dévorée par le dragon. » Il l’embrassa et la laissa partir en lui disant : « O ma fille, que ne suis-je mort avant toi pour te perdre ainsi ! » Alors elle se jeta aux pieds de son père pour lui demander sa bénédiction, et le père l’ayant bénie avec larmes, elle se dirigea vers le lac.
Or, saint Georges passait par hasard par là et, la voyant pleurer, il lui demanda ce qu’elle avait. » Bon jeune homme, lui répondit-elle, vite, monte sur ton cheval ; fuis, si tu ne veux mourir avec moi. » « N’aie pas peur, lui dit Georges, mais dis-moi, ma fille, que vas-tu faire en présence de tout ce monde ? » « Je vois, lui dit la fille, que tu es un bon jeune homme ; ton cœur est généreux : mais pourquoi veux-tu mourir avec moi ? Vite, fuis ! » Georges, lui dit : « Je ne m’en irai pas avant que tu ne m’aies expliqué ce que tu as. »
Or, après qu’elle l’eut instruit totalement, Georges lui dit : « Ma fille, ne crains point, car au nom de J.-C., je t’aiderai. » Elle lui dit : « Bon soldat ! Mais hâte-toi de te sauver, ne péris pas avec moi ! C’est assez de mourir seule ; car tu ne pourrais me délivrer et nous péririons ensemble. »
Alors qu’ils parlaient ainsi, voici que le dragon s’approcha en levant la tête au-dessus du lac. La jeune fille toute tremblante dit : « Fuis, mon seigneur, fuis vite. » A l’instant Georges monta sur son cheval, et se fortifiant du signe de la croix, il attaque avec audace le dragon qui avançait sur lui : il brandit sa lance avec vigueur, se recommande à Dieu, frappe le monstre avec force et l’abat par terre : « Jette, dit Georges à la fille du roi, jette ta ceinture au cou du dragon ; ne crains rien, mon enfant. » Elle le fit et le dragon la suivait comme la chienne la plus douce.
Or, comme elle le conduisait dans la ville, tout le peuple témoin de cela se mit à fuir par monts et par vaux en disant : « Malheur à nous, nous allons tous périr à l’instant ! » Alors saint Georges leur fit signe en disant : « Ne craignez rien, le Seigneur m’a envoyé exprès vers vous afin que je vous délivre des malheurs que vous causait ce dragon seulement, croyez en J.-C., que chacun de vous reçoive le baptême, et je tuerai le monstre. » Alors le roi avec tout le peuple reçut le baptême et saint Gorges, ayant dégainé son épée, tua le dragon et ordonna de le porter hors de la ville. Quatre paires de bœufs le traînèrent hors de la cité dans une vaste plaine. Or, ce jour-là vingt mille hommes furent baptisés, sans compter les enfants et les femmes.
Cette histoire se trouve dans les milliers de pages de la Légende dorée, de Jacques de Voragine.
Varaggio (aujourd’hui Varazze) était un village de pêcheurs sur la côte ligure. Il est probable que la famille était installée à Gênes depuis un moment quand naquit Jacques en 1228 ou 1229. Il entra très jeune dans l’ordre de Saint Dominique, fondé quelques dizaines d’années auparavant et en plein développement. Au vu de ses qualités, ses responsables le nommèrent prieur de la province de Lombardie, puis grand maître de l’ordre à titre temporaire. Enfin, le pallium d’archevêque de Gênes lui fut remis.
Prenant sa charge à cœur, il obtint en 1295 la réconciliation des Guelfes et des Gibelins, les deux factions qui s’entredéchiraient dans toutes les villes italiennes, et prit, monté sur un cheval, la tête de la procession qui traversa la ville. Puis il tenta aussi d’établir la paix entre Gênes et Venise, mais sans succès. Et dans sa ville même, les troubles reprirent bientôt, au point que la cathédrale San Lorenzo fut incendiée.
L’archevêque sollicita une aide du pape pour la reconstruire, puis mourut à soixante-dix ans dans la nuit du 13 au 14 juillet 1298.
De 1260 à sa mort, Jacques de Voragine n’a cessé de reprendre et d’enrichir son œuvre majeure qui raconte la vie merveilleuse des saints. Le succès fut étonnant : il s’en vendit quasiment autant que de bibles. En latin, mais surtout, une première pour un livre, dans toutes les langues européennes. Chacun connaissait alors les épisodes merveilleux des saintes et des saints et les peintres comme les créateurs de vitraux, durant des siècles, s’en inspirèrent. Le texte venait appuyer l’image, et l’image le texte. On reconnaissait l’histoire devant sa représentation.
A la Scuola toujours, Carpaccio a également peint le lion entrant dans le monastère avec sa patte blessée, accueilli par le vieux Saint Jérôme alors que les moines s’égaillent en tous sens, apeurés. Jérôme ôtera de sa patte l’épine qui le fait souffrir et ce lion deviendra le gardien de l’âne de la communauté, comme un chien fidèle.

Au milieu du XVIIe siècle, assez brusquement, la perception de ces récits change. Un siècle plus tard, des capucins des Ardennes peuvent par exemple commenter en marge de leur exemplaire : « Écrite avec piété mais sans critique et sans discernement, et même remplie de fables puériles et ridicules… Les savants qui ont lu ce livre accusent moins l’auteur que le mauvais goût de son siècle où l’on ne cherchait que le merveilleux. »
Les saints perdirent de leur fantaisie et gagnèrent en profondeur théologique. Dès lors, restèrent les tableaux et se perdirent les histoires. Les murs des musées devraient être tapissés d’extraits de la Légende dorée.
L’Église aurait-elle le sens de l’humour ? Ce dominicain fut béatifié par Pie VII en 1816 à la demande insistante des Génois. Il est donc bienheureux, mais non canonisé. Les saints du paradis, dont il chanta les merveilles, s’en amusent sans doute quand il leur arrive de l’y croiser.