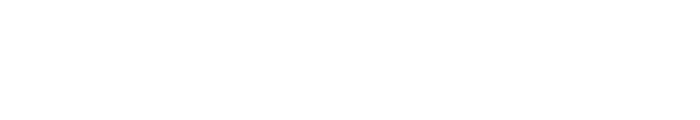Nous sommes dans le métro et on nous heurte, sans bien sûr la moindre excuse. Cela nous met en rage intérieurement et nous gâche notre journée.
« J’étais si soumis au monde qu’on ne me poussait pas du coude sans m’irriter. » Cette phrase a été écrite au XIVème siècle bien avant qu’il existât des métros ou des bus. Elle se trouve dans les œuvres du mystique flamand Jan Ruysbroeck.
Il était chapelain de la cathédrale Sainte Gudule de Bruxelles. Son biographe dit qu’il sortait peu, et qu’il marchait dans le monde en solitaire. Les traversées de la ville qu’il devait effectuer pour aller prêcher au béguinage de Molenbeek, dont il avait la charge et où sa mère s’était retirée, étaient chaque fois une épreuve. Il s’énervait que l’extérieur eût tant de pouvoir sur lui qu’un mot grossier ou un choc involontaire pussent suffire à l’ébranler et cherchait le réconfort dans les poèmes pleins de délicatesse de Hadejwich d’Anvers, une béguine elle aussi, morte un siècle auparavant.
A qui te fera bien ou mal, donne sans distinction ce dont il a besoin, lui conseillait-elle. L’amour t’accorde ce pouvoir : puisque tout t’appartient, donne tout. Elle l’appelait à être libre et vide, et à se préparer ainsi à l’étincelle. Mais le bruit des travaux de la cathédrale, l’affairement des ouvriers, les fêtes, l’effervescence de la ville flamande, continuaient de l’atteindre, jusque dans le cloître. Il se disait égaré parmi les choses qui tombent et qui coulent, incapable de trouver la science de l’habitation intérieure. Un jour que son oncle assistait à un office, le prédicateur qui jusque-là avait bafouillé son sermon retrouva ses esprits et dit : je parle pour que l’un de vous change de vie. Peu après, ils se retrouvèrent à trois au pied d’un pilier et décidèrent de quitter Bruxelles. Ce fut à la Pâques de 1343. Il avait attendu d’avoir cinquante ans, son oncle et leur troisième compagnon étaient bien plus âgés encore. Ils passèrent dans un ermitage abandonné en pleine forêt de Soignes, au creux d’une vallée – Groenendael. Leur première tâche fut de bâtir une clôture protectrice.
Qui étaient-ils ? Des religieux en rupture ? Inquiet, l’évêque de Cambrai vint à leur rencontre et leur demanda de rester dans l’Église en observant une règle faite de prière et de travail. Ils acceptèrent et il leur remit l’habit des Augustins, la robe blanche et le scapulaire noir. Ruysbroeck devint le prieur du petit monastère. Il voulait participer à toutes les tâches, même les plus humbles, mais on tendait à l’en dispenser : un jour qu’il s’était occupé du potager, absorbé en lui-même, il avait arraché sans les distinguer les pousses de salade avec les mauvaises herbes. On le laissait à ses méditations.
Avec douceur, il s’occupait des communautés de femmes des alentours. Pour une clarisse, il composa tout un livre. « Lorsque je suis passé dans votre monastère l’été dernier, lui écrit-il, il m’a semblé que vous étiez en peine. » Et il la console : « La vie sainte est chevalerie, qui ne vit que par l’épreuve. » Au milieu de la forêt, il trouvait le silence profond de la jouissance. Il se disait enfin absous de tous les nœuds du monde. De bon matin, il quittait sa cellule pour entrer dans la forêt. Il s’installait sur une pierre, au pied d’un vieil arbre et posait une tablette sur ses genoux. Parfois, quelque chose parlait en lui et il écrivait. Lorsque la voix se taisait, il restait immobile, sans plus aucune impatience. Il entrait en lui, disant adieu aux amours et aux douleurs du monde, avec une joie qui faisait fondre son âme.
A tout instant, commencer et parfaire était sa très haute exigence.
Jamais il n’écrivit en latin. Il n’usait que du vieux flamand, la langue de ses tendres échanges avec sa mère et Hadewijch, avec les béguines et moniales qu’il aimait et fortifiait. C’est avec ces mots-là, qui étaient ceux des paysans d’alentour, qu’il exprima son union mystique avec un être qui le dépassait tout en étant en lui. Un soir, il s’attarda. Le cuisinier partit à sa rencontre, s’enfonçant dans la forêt de plus en plus sombre, lentement, un peu de crainte de tomber mais surtout de le troubler. Il l’aperçut enfin, entre les branches, sur sa pierre habituelle. Il lui sembla éclairé. Était-ce un rayon de lune posé juste sur lui ? Était-ce qu’il regardait la lumière, par la lumière, en la lumière, comme il l’avait écrit ? L’homme en fut bouleversé. L’un des premiers, il avait rejoint la communauté et il était devenu leur homme à tout faire, s’occupant du jardin, des bâtiments, et des animaux. Pendant qu’ils rentraient tous deux dans la nuit, il osa demander qu’on lui apprît à lire et à écrire. Par la suite, il composa dix-huit traités et quatre opuscules. Toute son œuvre parle de l’humilité, dont il dit que jamais nul ne parla aussi bien que son maître. Il avait lu dans les livres de ce dernier que nous sommes tous appelés à être des voyants.
A son contact, on se sentait devenir meilleur, disait-on. Les cuisiniers eux-mêmes se transformaient en mystiques. Deux siècles après sa mort, un chartreux qui le lisait l’appela l’admirable. Le pape Pie X l’a béatifié en 1908 et il est célébré par l’Église le 2 décembre.
La pointe aiguë d’un coude s’enfonce au creux de nos côtes, un mot rude ou simplement maladroit dans notre esprit, et de l’énervement que provoque cet ébranlement naît le rêve de défaire, un à un, les nœuds durcis qui entravent nos vies.
Parfois, même longtemps après, ce rêve revient et nous change.